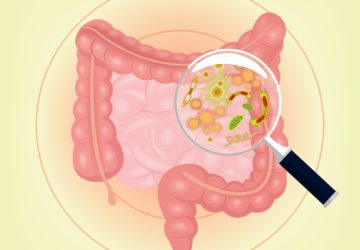Vitamine D : une ‘mégadose’ avant l’hiver n’est pas une solution santé et n’améliore pas l’immunité
La supplémentation en vitamine D revient chaque automne comme un rituel quasi réflexe : la luminosité diminue, la fatigue s’installe, et les doses uniques fortement concentrées[1] – 25.000, 50.000 ou 100.000 unités internationales (UI)– sont adoptées comme une solution simple et pratique. Pourtant, la physiologie et les études scientifiques convergent : ces apports très élevés ne reproduisent pas du tout le fonctionnement naturel du métabolisme de la vitamine D. Ils peuvent même, dans certains cas, perturber la régulation hormonale, diminuer l’efficacité immunitaire et augmenter certains risques.
Comprendre pourquoi la régularité importe plus que l’intensité permet d’ajuster l’accompagnement de manière plus précise, plus sûre et plus efficace.
Comment fonctionne réellement la vitamine D dans le corps?
La vitamine D n’agit pas comme une simple « vitamine » : c’est une hormone stéroïdienne. Une fois ingérée ou synthétisée par la peau, elle suit deux étapes d’activation : d’abord dans le foie, puis dans le rein et dans de nombreuses cellules immunitaires et musculaires. Le produit final, la 1,25(OH)₂D, agit comme un messager qui active des centaines de gènes. De cette manière, la vitamine D influence entre autres l’équilibre osseux, l’immunité, l’inflammation et le fonctionnement musculaire.
De nombreuses cellules du système immunitaire activent elles-mêmes la vitamine D pour déclencher la production de peptides antimicrobiens. Pour fonctionner, ces cellules ont besoin d’un niveau constant de vitamine D circulante, et non pas d’un pic suivi d’une retombée. La vitamine D agit donc comme une hormone à flux continu.
Les ‘mégadoses’ ponctuelles semblent attractives… mais posent problème
Les doses uniques très élevées sont populaires pour leur praticité : une prise et on n’y pense plus pendant plusieurs semaines. Le problème, c’est qu’elles induisent une cinétique totalement différente de celle observée avec une exposition solaire naturelle.
Un apport (bolus) massif provoque :
- une élévation brutale de la vitamine D circulante;
- puis une stimulation excessive des enzymes de dégradation de celle-ci;
- suivie d’une chute progressive du taux circulant;
- tandis que les tissus de l’organisme reçoivent une stimulation hormonale instable.
Cette oscillation n’est pas neutre : elle perturbe l’équilibre entre activation et dégradation, et peut altérer les effets attendus, notamment sur le système immunitaire et le tonus musculaire.
Ce que montrent les études scientifiques récentes
Les essais contrôlés et méta-analyses publiés ces dernières années[2] sont remarquablement cohérents :
- les bolus de 100.000 UI ou plus n’améliorent pas la prévention du risque de fracture, de chute ou d’infection;
- plusieurs études montrent même une augmentation transitoire du risque de chute dans les semaines suivant un bolus élevé, en lien supposé avec un déséquilibre calcique, l’altération transitoire de la fonction musculaire et des réponses hormonales compensatoires[3] ;
- les doses quotidiennes ou hebdomadaires modérées (en général 800 à 4.000 UI/j) produisent des résultats supérieurs, tant sur l’immunité que sur la fonction musculaire;
- les schémas de prise réguliers créent une stabilité hormonale qui reflète mieux la physiologie.
Ainsi, la répétition s’intègre bien mieux dans une logique santé qu’un choc unique.
Immunité : pourquoi la vitamine D a besoin de régularité pour être efficace
La vitamine D aide notre système immunitaire à se défendre contre les infections. Elle stimule la production de certaines molécules de défense, appelées peptides antimicrobiens, qui agissent un peu comme des anti-bactériens naturels dans notre corps. Ce processus n’est pas instantané : il faut un certain temps pour que les cellules immunitaires «réagissent » et fabriquent ces peptides, en général entre 12 et 36 heures. Si l’on ingère une très grosse dose d’un coup, le signal ne dure pas assez longtemps pour soutenir cette production. En revanche, des prises régulières, même modérées, maintiennent la stimulation et permettent à notre immunité innée de rester active et efficace.
Comparaison des schémas de supplémentation
Conséquences d’un apport élevé en une prise de 25.000 à 100.000 UI :
- hausse rapide mais transitoire de la vitamine D;
- qctivation forte puis contre-régulation rapide;
- effets immunitaires faibles ou inconsistants;
- déséquilibre calcique, altération transitoire de la fonction musculaire et réponses hormonales compensatoires.
Conséquences de prises quotidiennes (800 à 4.000 UI):
- Cinétique stable;
- Meilleure activation de la fonction immunitaire;
- Amélioration du tonus musculaire;
- Risques minimes.
La physiologie humaine n’aime pas les montagnes russes hormonales : elle préfère les valeurs stables.
Quelle vitamine D?
Il existe deux grandes formes de vitamine D:
- la vitamine D₂ (ergocalciférol) :
- d’origine végétale (souvent issue de levures ou champignons exposés aux rayons UV);
- historiquement utilisée dans les compléments végétaliens;
- moins biodisponible et moins stable que la D₃ chez l’humain;
- ne montre pas d’effet positif sur la santé.
- la vitamine D₃ (cholécalciférol) :
- naturellement produite par la peau sous l’effet des UVB;
- généralement extraite de lanoline (laine de mouton); il existe également une D₃ végétale (issue de lichens)
- plus efficace et sûre pour arriver à un bon statut vitaminique.
Seule la vitamine D₃ augmente et maintient le taux de vitamine D circulante dans l’organisme humain et démontre des effets santé.
Autres micronutriments importants
L’efficacité de la vitamine D dépend d’autres nutriments :
- le magnésium : indispensable à toutes les étapes d’activation. Une carence diminue fortement la réponse aux doses habituelles.
- la vitamine K2 : agit en synergie avec la vitamine D pour la santé des os et du cœur : la vitamine D aide à l’absorption du calcium, tandis que la K2 le dirige vers les os. Ensemble, elles optimisent la minéralisation osseuse, renforcent les os et soutiennent le système cardiovasculaire. La prise de vitamine K2 ne doit toutefois en aucun cas être surdosée et est contre-indiquée en cas de prise d’anticoagulants.
- le zinc et vitamine A : permettent aux cellules de mieux utiliser la vitamine D pour activer les mécanismes de défense et d’autres fonctions de l’organisme.
Une supplémentation régulière en vitamine D fonctionne donc d’autant mieux que ces cofacteurs sont disponibles. Pour autant, il est important de ne pas les supplémenter de manière autonome ; un accompagnement par un professionnel de santé est conseillé pour éviter tout excès ou interaction.
Quelle stratégie privilégier en automne et en hiver?
Pour la majorité des adultes :
- privilégier une prise quotidienne régulière de vitamine D3 ;
- adapter la dose entre 800 et 4.000 UI selon le statut initial, dont une partie sera prise sous forme combinée à la vitamine K2 (cette dernière ne devant toutefois pas être surdosée) ;
- ne recourir aux bolus que sur avis médical.
Conclusion
La supplémentation en vitamine D gagne à s’inspirer du fonctionnement naturel du corps : régularité, stabilité et cohérence hormonale. Les mégadoses ponctuelles, bien qu’attractives, ne reproduisent pas cette dynamique et peuvent même créer des déséquilibres. Les prises quotidiennes, elles, maximisent les bénéfices et minimisent les risques.
Cet article a une vocation strictement informative. Il ne remet pas en question les décisions médicales individuelles, qui tiennent compte du contexte clinique propre à chaque patient. Toute décision de complémentation — dose, durée, forme — doit idéalement être discutée avec un professionnel de santé.
[1] dans le langage médical, on parle de bolus, qui désigne l’administration d’une dose unique, élevée et rapidement disponible
[2] Voy. : Myung SK, Cho H. Effects of intermittent or single high-dose vitamin D supplementation on risk of falls and fractures: a systematic review and meta-analysis. Osteoporos Int. 2023 Aug;34(8):1355-1367. doi: 10.1007/s00198-023-06761-3. Epub 2023 Apr 29. PMID: 37120684 ; Singh S, Meena RK, Maharshi V, Sinha N, Agarwal N, Payra S, Harsha D. Vitamin D supplementation trials: Navigating the maze of unpredictable results. Perspect Clin Res. 2025 Apr-Jun;16(2):69-74. doi: 10.4103/picr.picr_325_23. Epub 2025 Jan 31. PMID: 40322473; PMCID: PMC12048097 ; Kong SH, Jang HN, Kim JH, Kim SW, Shin CS. Effect of Vitamin D Supplementation on Risk of Fractures and Falls According to Dosage and Interval: A Meta-Analysis. Endocrinol Metab (Seoul). 2022 Apr;37(2):344-358. doi: 10.3803/EnM.2021.1374. Epub 2022 Apr 25. PMID: 35504603; PMCID: PMC9081312.
[3] Sanders KM, Stuart AL, Williamson E J, Simpson JL, Kotowicz MA, Young D, Nicholson GC. Annual high‑dose oral vitamin D and falls and fractures in older women: a randomized controlled trial. JAMA. 2010; 303(18): 1815–1822